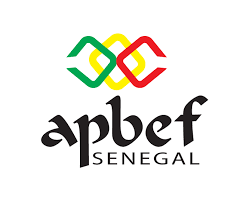INCIVISME ROUTIER DANS LE MACKY
Dis-moi comment tu (te) conduis, je te dirai qui tu es !
L’exception sénégalaise :
Il est de bon ton de considérer le Sénégal non pas comme un pays à part entière, mais comme un pays entièrement à part.
Ainsi, les problèmes qui ont trouvé des solutions pérennes à travers le monde font ici l’objet de débats sans fin. C’est le cas de la circulation routière qui, fruit de l’urbanisation galopante et de l’émergence des classes moyennes, draine quotidiennement des torrents de véhicules dont la logique de fonctionnement défie le bon sens et illustre la théorie des rats :
- Isolés, ce sont des animaux sans histoires,
- Mis en communauté, ils laissent apparaître des signes d’organisation, voire d’intelligence,
-Plus ils se reproduisent, et plus cette organisation se perfectionne, jusqu’au seuil de surpopulation où ils s’entre-dévorent, revenant à l’état sauvage.
Le principe de base sur lequel se fonde la mobilité routière est que la route appartient à tout le monde, et elle doit être partagée en responsabilité, chacun prenant soin de l’outil et de son environnement. Il semble qu’au Sénégal, nous ayons pris le parti de considérer que la route n’appartient à personne, dès lors chacun y fait ce qui lui plait, en toute impunité.
Et ceux qui sont sensés veiller à l’harmonie du système sont souvent les premiers à lui porter des coups, soit par un usage abusif de leurs prérogatives, soit par une démission face à leurs responsabilités.
Les 10 péchés capitaux :
Le catalogue des « bonnes pratiques » est quasiment sans limite :
-La voie : On choisit son couloir selon sa sensibilité politique, donc majoritairement à gauche, et en changer reviendrait à se renier. Plutôt crever ! En revanche, s’il y a quelque espace ou intérêt à glaner à droite, on peut s’autoriser une incursion furtive, quitte à se rabattre sur un innocent ;
-La vitesse : Elle est définie par l’état d’esprit du conducteur sans tenir compte du panneautage et de son environnement. Cette remarque concerne particulièrement ces conducteurs de transports en commun âpres au gain, qui n’hésiteraient pas à rouler sur plus petit qu’eux pour gagner un client ;
-Les passages piétons : Purement décoratifs, zones à risques par excellence car si un conducteur averti s’arrête pour vous laisser passer, attention au crétin de service qui va accélérer et voyant un espace vide, fauchera sans états d’âme cette personne âgée ou cet enfant qui ne se doutait pas qu’on pouvait croiser aussi bête et méchant par une si belle journée ;
-Les distances de sécurité : sacrifiées depuis belle lurette au profit de l’aspiration, supposée réduire la consommation et faire gagner du temps. A vouloir chasser le dernier centimètre, en ville comme sur autoroute, le moindre écart ou ralentissement se transforme en carambolage ;
-La priorité aux intersections : Le casse-tête par excellence entre la priorité à droite, la voie à grande circulation et l’avantage donné sur les rond-points au véhicule déjà engagé. La confrontation donne droit à une guerre des nerfs où celui qui a la priorité avance à pas feutrés, parce que celui qui doit lui laisser l’avantage continue d’avancer insidieusement, fermant l’angle jusqu’au point de contact. Il serait tellement plus simple de marquer son intention de laisser l’avantage quelques mètres avant l’intersection en ralentissant clairement, et s’arrêter à la ligne blanche qui la délimite…
-Le téléphone au volant : Les sénégalais seront comblés le jour où une application leur permettra de conduire leur véhicule à partir de leur smartphone. On a beau leur dire que l’hémisphère du cerveau qui gère la conversation téléphonique est le même que celui qui gère la conduite et qu’entre conduire et téléphoner, il faut choisir, ils restent convaincus d’être assez brillants pour combiner les deux. Résultat des courses, chaque fois que vous voyez une voiture quitter sa ligne ou décrocher sa vitesse sans raison apparente, regardez à l’intérieur, vous y verrez un écran allumé et un conducteur en train de « régler des problèmes », au risque de vous en créer…
-Le sens giratoire : Pourquoi diable faire le tour d’un rond-point pour prendre la bretelle à gauche alors qu’elle nous tend les bras, Quitte à se trouver nez-à-nez avec ceux qui arrivent dans le bon sens ? La question reste sans réponse…
-L’arrêt et le stationnement : Ce qui restait la spécialité des taxis a basculé dans le tronc commun : rétroviseur, clignotant et feu de stop sont ravalés au rang d’encombrants, on s’arrête où et quand on veut, sans préavis, et comme en cas d’accident, celui qui est derrière est déclaré fautif pour n’avoir pas respecté la distance de sécurité, la messe est dite. Sauve-qui-peut ;
-La conduite sous la pluie : quelle pluie ??? Les voitures et les conducteurs étant étanches, on ne change rien, ni la vitesse, ni les distances de sécurité, pas même les essuie-glaces ;
-La conduite de nuit : Voir et être vu présuppose des phares bien réglés, utilisés en mode « feux de croisement » alias feux de code. Dans la pratique, et surtout sur route non éclairée et autoroute, il est de bon ton de rouler en phares, surtout si on est au volant d’un 4x4 surélevé afin qu’aucun détail de la route ne nous échappe, au risque d’éblouir ceux qui nous précèdent ou nous croisent.
N’en jetez plus, la coupe est pleine… Enfin, non !
Car il y a ces policiers qui règlent la circulation téléphone en main, laissant filer sous leurs aisselles un essaim de scooters et motos lestés de 3 équilibristes sans casque ni masque, qui se paient le luxe de brûler un feu rouge et une priorité dans l’indifférence générale, car se croyant exemptés de code ;
Sans oublier cette gestion fantaisiste de la circulation par la maréchaussée, qui s’éclate en libérant en simultané et non en alternance deux files de voitures opposées, qui ont la ferme intention de se croiser ET de se contourner – méli -mélo garanti ;
Et ces piétons qui débarquent sur le macadam sans crier gare, téléphone à l’oreille, en tournant le dos aux véhicules, s’en remettant à leur bonne étoile à défaut de couverture médicale.
Voilà comment un pays de Droit devient un pays de non-Droit.
La politique de contournement :
Ce capharnaüm est le triste résultat d’un anticonformisme congénital et contagieux, car les étrangers vivant au Sénégal, toutes origines confondues ont vite fait de se dépouiller de leur discipline acquise pour prendre le pli local comme s’ils l’avaient tété au biberon.
Preuve s’il en est que la discipline n’est pas innée, mais le fruit d’un conditionnement.
Dans un système normé, un accident est un incident survenu alors que tout a été fait pour l’éviter, il constitue donc par définition l’exception. Au Sénégal, au regard de l’état général des véhicules et du comportement des usagers de la route, l’accident constitue la règle, la suite logique de comportements erratiques répétés par des serial-gaffeurs. Rentrer chez soi sans une éraflure ou une aile défoncée relève du miracle quotidien.
Comment en est-on arrivé là ? Probablement par notre incapacité à s’autoévaluer, notre goût immodéré pour l’autosatisfaction, et cette conviction d’être plus malins que tous les autres peuples réunis, au point de trouver des parades « innovantes » à tous les problèmes classiques :
-Les automobilistes empiètent sur le bas-côté, transformant une 3 voies en 5 voies ? On met des trottoirs infranchissables. Résultat, plus de voies de dégagement, la moindre panne ou le moindre accrochage se traduit par 30 minutes de bouchons, puisque même les gendarmes et les secours ne trouvent pas d’accès aux lieux des sinistres ;
-Les rond-points sont des goulots d’étranglements ? On construit des ponts et des tunnels afin de supprimer les points de croisement, mais on laisse des centaines de marchands ambulants transformer une voie rapide en marché aux souks où on s’arrête pour négocier les prix ou attendre sa monnaie, annulant de ce fait des milliards de francs cfa d’investissements.
Pourtant, une rapide comparaison avec des pays candidats à l’émergence comme le Sénégal tels que le Ghana, le Rwanda, le Cap-Vert et le Botswana permettrait de comprendre que les solutions aux problèmes complexes sont souvent simples, et reposent avant tout sur une volonté politique inflexible, l’éducation des populations afin d’atteindre une masse critique de citoyens conformistes, et le refus de solutions en trompe-l’œil proposées par les bailleurs toujours prêts à vendre leur expertise à prix d’or, moyennant des montages financiers complexes « d’aide liée » qui au final, remontent l’essentiel de la ressource financière à la source sous forme de sociétés concessionnaires, honoraires de consultants et de formateurs, licences d’exploitation et tutti quanti.
La solution est en nous, individuellement et collectivement, à travers le retour à une conduite vertueuse et responsable, reflet d’une citoyenneté conquérante.
Le retour aux fondamentaux du code de la route :
Langage commun à l’ensemble des citoyens de ce monde, le code international de la route a été conçu pour prévenir toutes sortes de conflits entre les usagers, grâce à un catalogue de règles de conduite à appliquer sans interprétation, afin d’éviter les incompréhensions sources d’accidents.
La version francophone conçue par ce cher Monsieur Rousseau, pas celui de l’Encyclopédie, l’autre, est un best-seller sur lequel le temps n’a pas de prise, et qui a rendu service à des millions d’usagers.
Tout conducteur est supposé le maîtriser suite à un processus de formation en auto-école sanctionné par l’obtention d’un permis de conduire.
Dès lors, comment admettre que sitôt le permis obtenu, ces conducteurs reviennent à l’état primitif, sans foi ni loi ?
De même que les excès de vitesse ont été résolus par les radars et l’alcool au volant a été jugulé par l’alcootest, l’incivisme routier sera neutralisé par un dispositif répressif basé sur la force de la Loi et la pédagogie.
Ainsi, il convient de rétablir le code de la route dans ses prérogatives :
-Par une formation de mise à niveau des agents de police, de gendarmerie, les ASP et agents communaux afin de lever toutes les ambiguïtés quant à l’application de la réglementation routière ;
-La même démarche devra être menée auprès des entreprises de transport public et privé : taxis, bus, camions, des entreprises à flotte de véhicules lourds, ainsi que des corps d’élus et d’élite : gouvernement, députés, élus locaux, ordres des professions libérales, groupements professionnels d’employeurs et de travailleurs ;
-Par une campagne nationale de sensibilisation aux enjeux de la citoyenneté routière via la télévision, les radios, journaux et presse en ligne, les écoles, lycées et universités, à travers des spots didactiques et des tutoriels quotidiens afin que nul n’ignore les fondamentaux de la sécurité routière,
-Par une application stricte du code de la route, avec identification rigoureuse et impartiale des infractions, suivie d’une application sans complaisance des sanctions prévues par la loi, dans un souci permanent de pédagogie, de sensibilisation et de responsabilisation.
Et que l’on ne nous divertisse pas avec le spectre du permis à points, ce sera encore une fois l’occasion de nous refiler une technologie importée coûteuse et contre-productive, à l’image du défunt visa de tourisme. De toutes façons, la modicité des contraventions ne permettrait pas de rembourser l’investissement, et la multiplication débridée des conducteurs sans permis deviendrait vite une équation sans issue pour nos autorités.
D’autant que dans ce pays où chacun est à la recherche d’un parent bien placé en politique, dans l’administration ou dans les confréries pour lui régler ses problèmes, quitte à fouler les règlements du pied, les règles communautaires priment sur les règles de la République.
Voilà comment un pays de non-Droit devient un pays de passe-Droit.
Ainsi donc, la solution devrait être recherchée dans la transition numérique, à travers :
-La généralisation des caméras de surveillance du trafic automobile, avec identification automatisée des infractions, couplée à la vigilance des agents de la circulation, et transmission des contraventions via les smartphones pour un paiement par transfert d’argent ;
-L’informatisation des permis de conduire incluant l’historique des infractions constatées, et un lien avec le téléphone personnel du conducteur afin d’assurer une bonne traçabilité ;
-L’élaboration d’une échelle des infractions avec des sanctions appropriées : pécuniaires pour les premières commises, puis assorties de travaux d’utilité publique : aide à la circulation urbaine avec la police, séances de sensibilisation dans les écoles ou nettoyage des rues avec les équipes de l’UCG.
Et en cas de conduite sans permis suite à un retrait pour multirécidive, incarcération en commissariat de police pour 24 heures, et plus si affinités.
Afin que cesse le règne de l’irresponsabilité et de l’impunité.
Dieggelou xeewina : l’appel à la responsabilité :
La manière dont on se conduit sur la voie publique est le reflet du niveau d’éducation et/ou de répression des citoyens. Il n’est donc pas étonnant que les pays scandinaves, du fait de leur haut niveau de citoyenneté, soient des modèles en matière de prévention et de responsabilité routière qui s’appuient sur des principes accessibles à tous : prévisibilité, bienveillance, courtoisie et responsabilité :
-On respecte les infrastructures, le mobilier urbain et l’environnement (voitures, piétons) ;
-On respecte son prochain et partage la route en bonne intelligence (bien commun) ;
-On annonce ce qu’on va faire (arrêt, ralentissement, changement de direction) et on s’y tient ;
-On s’abstient d’interpréter le code de la route, source de malentendus, pour une application stricte ;
-On s’assure et adopte un comportement responsable en toutes circonstances : on casse, on paie !
Le Sénégal pourra prétendre être sur la rampe de l’émergence le jour où ses citoyens auront intégré le fait que leur attitude au quotidien, notamment sur la voie publique, est le reflet de leur prise de conscience de leurs droits et leurs devoirs. Elle traduit leur capacité à vivre en société en bonne intelligence, avec un objectif commun tendant vers un développement durable.
Aussi longtemps que chacun continuera de suivre ses bas instincts, convaincu d’être soit intouchable, soit insolvable, nous continuerons à être guidés par des comportements irresponsables ponctués par ce sempiternel mot d’excuse « mangui dieggelou » qui résume à lui-seul l’incurie de notre société du « maslaa ».
Il est grand temps que les citoyens aient des actes au quotidien en accord avec leur éthique afin d’assumer ici-bas les conséquences de leurs turpitudes, ce qui ne les empêchera pas d’en répondre lors de leur jugement dernier.
Coach Barma
credo.sn@gmail.com