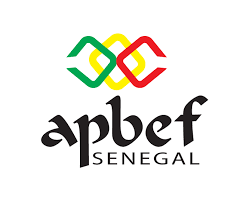ISLAM, TERRORISME, BLASPHEME ET LIBERTE D'EXPRESSION
/Pourquoi l'islam interdit les attentats
INTERVIEW. Comme le rappelle le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne, d'après le Coran, le musulman est détruit par le mal qu'il commet.
Propos recueillis par Catherine Golliau - Publié le 22/12/2016 à 06:37 | Le Point.fr
Souleymane Bachir Diagne est philosophe et professeur à l’université de Columbia, auteur, entre autres, de Comment philosopher en islam (Éditions du Panama, 2008). © Photo Antoine Tempé
Le Point.fr : « Musulman » signifie en arabe « soumis » : le croyant se soumet au Dieu unique et tout-puissant. Comment peut-il disposer d'un libre arbitre ?
Souleymane Bachir Diagne : La sourate 2 du Coran est claire à ce sujet : l'humain est le seul être capable de troubler l'ordre établi, parce que Dieu a voulu le créer libre. Le récit de la création en islam est en effet très différent de celui que nous livre la Genèse dans la Bible. Dans cette sourate, Dieu prévient les anges qu'il va se donner un représentant sur terre. Ces derniers s'inquiètent qu'il veuille établir sur terre un lieutenant, un calife. Ne va-t-il pas faire advenir le mal et le sang ? Mais Dieu leur répond : « Je sais que vous ne savez pas. » Et il passe outre. En fait, il crée un fauteur de troubles. Il le fait libre, et cette liberté fait advenir le mal. La conséquence de cette création sera notamment la rébellion d'Iblis, un ange qui refuse de se prosterner devant l'homme et qui dit à Dieu : « Je suis meilleur que lui. Tu m'as fait de feu, et lui d'argile. » Il est le Satan de l'islam, celui qui n'aura de cesse de tenter l'humain pour le faire chuter.
Mais comment se définit le mal en islam ? Est-ce, comme dans le cas d'Iblis, se révolter contre la volonté de Dieu ?
Si l'on se fonde sur le Coran, faire le mal, c'est se faire du tort à soi-même. En arabe, on dit dhulm nafs, faire du tort à son âme. Quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu et sont chassés du paradis, ils se repentent et disent : « Seigneur, nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes. » En islam, le mal que l'on fait à l'autre nous détruit parce qu'il annihile l'humanité que nous portons en nous. Pour le sage soufi Tierno Bokar, « toute chose retourne à sa source ». Le mal se retourne toujours contre celui qui l'a commis. L'analyse philosophique que j'en fais, et je me place pour cela dans la lignée du grand penseur indien Mohammed Iqbal, est que le mal nous fait oublier qui on est, et donc oublier notre relation à Dieu. De fait, être musulman peut se résumer par trois dimensions : d'abord avoir la foi, iman, en Dieu, son message – le Coran –, et son œuvre – la création. Ensuite, avoir le respect de ce qui fait de soi un musulman. Enfin, l'excellence de caractère, ihsan, en arabe. Dans un hadith célèbre, Mohammed dit : « Adorer Dieu comme si on le voyait en sachant que si on ne le voit pas, lui nous voit. » Il faut agir en ayant constamment la conviction que l'on est en face ou sous le regard de Dieu. Ce qui implique que si l'on vit pleinement sa foi en l'islam, il y a des choses que l'on ne fait pas.
Quel est le rôle de la Loi, la charia ?
Elle définit les bonnes pratiques. Mais c'est un mot valise au sens très étendu. Le Coran ne le cite même pas. Aujourd'hui, elle désigne le comportement que doit suivre le bon musulman tel que l'ont défini au cours des siècles des juristes en se fondant sur le Coran, les hadiths, c'est-à-dire les mots et les gestes du prophète Mohammed et de ses compagnons les plus proches. Ce n'est pas elle qui définit les valeurs éthiques. Celles-ci relèvent d'un humanisme fondé sur la dignité de l'homme, dont le Coran est la base. Comme le dit le verset 30 de la sourate de la Vache, Dieu a créé l'homme pour qu'il soit son « calife », c'est-à-dire son lieutenant sur terre. Le mot « calife » est très fort. Et c'est d'ailleurs la seule référence au califat qui soit présente dans le Coran. L'humain est le lieutenant de Dieu, il tient la terre pour lui. Il est responsable de la création de Dieu. C'est là sa dignité et une responsabilité énorme. C'est donc à partir de cette responsabilité que l'on définit le bien et le mal. Je conseille à tous la lecture du philosophe autodidacte andalou (Hayy Ibn Yaqdhan) d'Ibn Tufayl, du XIIe siècle, qui aurait, dit-on, inspiré Daniel Defoe pour son Robinson Crusoé.
L'histoire d'un enfant sauvage ?
Oui, C'est l'histoire d'un jeune garçon qui, seul sur une île déserte, doit découvrir le monde par lui-même. Il va pour cela développer sa capacité de déduction de manière quasiment scientifique. Mais pour survivre, il doit manger des plantes et des animaux et donc détruire la nature. C'est l'occasion pour lui de prendre conscience non seulement de la grandeur et de la beauté de cette nature, mais aussi de sa responsabilité vis-à-vis de la création voulue par Dieu. Ce qu'il prend, il doit le rendre, d'une manière ou d'une autre. L'homme ne fait que participer à la création, dont il est le gardien.
Les actes du musulman ne sont-ils pas divisés entre ce qui est haram, autorisé, et halal, interdit ?
Contrairement à ce que l'on pense trop souvent, l'islam n'est pas un code, ce n'est pas une religion qui se définit par des pratiques autorisées ou non. Il suffit de lire Le Livre du licite et de l'illicite, le fameux ouvrage d'Al Ghazali, l'un des plus grands théologiens de l'islam, pour se rendre compte que le sujet est beaucoup plus compliqué que l'établissement d'une simple liste de pratiques. Aujourd'hui que sévit une vision rétrécie de l'islam, motivée par une affirmation identitaire et tribaliste, ces notions de licite et d'illicite s'appliquent à tout et n'importe quoi. Or cela ne repose sur rien. Certes, le Coran parle de « licite », mais c'est uniquement pour la nourriture. Et sont considérés comme « licites » les mets sur lesquels le nom de Dieu a été prononcé. Il ne dit rien de plus. Longtemps, les musulmans qui vivaient en Europe ont mangé de la viande « cachère » faute de pouvoir manger de la viande « hallal ». Et le grand mufti égyptien Mohammed Abduh, au début du XXe siècle, n'a pas hésité à considérer comme licite la nourriture tuée dans le monde chrétien selon les rites chrétiens. Le fondamentalisme, notamment salafiste, nie la fluidité juridique de l'islam telle qu'elle a été élaborée au cours des siècles par ses écoles juridiques. Les fondamentalistes veulent aujourd'hui figer cette jurisprudence au mépris des intérêts de l'homme. Or, comme le rapporte un hadith, Dieu a dit : « Nous avons ennobli les enfants d'Adam. » Cette idée de la noblesse de l'être humain, qu'il soit homme ou femme, est essentielle en islam. Celui qui sauve une vie sauve l'humanité. L'homme est au centre de la création, tout doit être fait pour son bien. Ceux qui réduisent l'islam à des pratiques qui nient l'humain ne font que l'instrumentaliser.
S'il fallait définir l'islam par un mot, pourrait-on dire que c'est la religion de la responsabilité, quand le christianisme, par exemple, se définit par l'amour du prochain ?
L'islam n'est pas moins une religion de l'amour qu'une autre. Le grand mystique Rûmi, à l'origine des derviches tourneurs, a dit : « Ma religion, c'est l'amour. » Mais vous avez raison en disant que c'est une religion de la responsabilité par rapport à la création de Dieu. Et c'est même une responsabilité très grande, qui n'a vraiment rien à voir avec l'islam d'Internet.
Le Point Références "Le bien et le mal" est vente en kiosque pendant deux mois, ou disponible dans notre boutique. 7,50 euros.
Souleymane Bachir Diagne est philosophe et professeur à l'université de Columbia, auteur, entre autres, de Comment philosopher en islam (Éditions du Panama, 2008), L'Encre des savants : réflexion sur la philosophie en Afrique (Présence africaine, 2013) et, avec Philippe Capelle-Dumont, de Philosopher en islam et christianisme (Cerf, 2016).
Caricaturer le prophète ? Ce qu’en dit le Coran, ce qu’en font les hommes ...
L’historienne et anthropologue Jacqueline Chabbi, grande spécialiste des origines de l’islam, explique comment la figure de Mahomet est piégée entre caricatures et images saintes.
Par Jacqueline Chabbi (Historienne)
Publié le 14 novembre 2020 à 18h00
Temps de lecture 6 min
Représentation de la monture miraculeuse qui permet à Muhammad de visiter les cieux lors du Mi’râdj, le voyage céleste. Ce voyage est inventé dans la tradition musulmane postérieure au Coran mais connaît un grand succès jusqu’à l’époque moderne. Cette image a été publiée à Tunis par la librairie al-Manâr, probablement au début du XXe siècle.
En tant qu’homme, celui que le monde musulman considère comme un prophète est mort en 632 de l’ère commune soit au début de l’an 11 de l’hégire. Alors, face à ceux qui prétendent défendre une figure qu’ils sacralisent et qui se clament choqués lorsqu’ils sont mis en présence d’un dessin de presse, il peut être important de revenir au cadre de vie historique de celui qu’ils veulent venger.
Peut-on comparer Yahvé et Allah ?
Le Coran connaît effectivement une notion que l’on pourrait, à première vue, assimiler à « l’offense ». Ainsi est-il question de ceux qui s’en prennent (verbalement), yu’dhûn, à celui que le Coran nomme soit le Prophète (al-nabî) soit le Messager d’Allâh (rasûl Allâh), comme dans la sourate IX, verset 61 et la sourate XXXIII, verset 57. Il s’agit donc bien de Muhammad. A ceux qui font cela, donc aux contemporains de Muhammad qui le contestent, le Coran promet un « tourment douloureux », ’adhâb alîm.
Le châtiment dans les seules mains d’Allah
Certains, aujourd’hui, croient manifestement qu’un tel passage peut les conduire à armer leur bras pour appliquer eux-mêmes le châtiment promis. Il n’en est évidemment rien. C’est un total contresens sur le texte sacré dont ils se réclament. Dans le Coran, le tourment désigné par le terme ’adhâb est dans la main du divin et de lui seul. Il n’y aucune ambiguïté à cet égard. Aucun homme n’est en mesure de s’en attribuer l’exécution. Il s’agit en outre d’une menace qui est le plus souvent de type eschatologique, comme dans les versets signalés, ou alors il est question des légendes de peuples disparus ou de cités détruites (sourate XVIII, v. 59), dans la disparition et la destruction desquels le Coran voit la main de son dieu, qui serait ainsi en capacité d’exercer sa vengeance en ce monde.
De la difficulté de dessiner Mahomet
Mais il y a beaucoup plus significatif encore si on interroge le Coran à partir des mots de son texte et de leur valeur d’usage dans la société de Muhammad, au VIIe siècle, en Arabie. Le mot que l’on peut comprendre aujourd’hui comme l’« offense » et qui serait passible du tribunal est représenté dans la société du Coran et dans le Coran lui-même comme un « dommage », adhâ. Mais dans la mesure où ce dommage reste dans l’ordre de la parole, même s’il s’agit d’une insulte – comme c’est le cas dans CVIII, 3 ou LXIII, 8 –, ce dommage n’entraîne aucune sanction. Dans ce cas, il est simplement conseillé de pratiquer le tawakkul, autrement dit la « remise » au divin qui saura, lui, punir comme il se doit (XXXIII, 48 ; XIV, 92). Dans la société du Coran, ce que l’on pourrait appeler le dommage moral n’était donc pas sanctionnable. Tout au plus pouvait-on répondre sur le même ton, notamment par l’intermédiaire de la poésie satirique, qui était l’un des arts les plus prisés dans la société de l’époque.
L’indifférence ou la caricature en retour
Si donc on transpose cette disposition du Coran dans les conditions d’aujourd’hui, cela reviendrait à dire qu’à la caricature jugée insultante ne peut répondre que l’indifférence ou alors une caricature en retour. En revanche, il en allait tout autrement du dommage physique qui entraînait blessure ou mort. Dans ce cas, que l’acte soit intentionnel ou non, c’était le qisâs qui s’appliquait, autrement dit la règle de compensation du dommage dite aussi loi du talion, à moins qu’un arrangement puisse être trouvé entre les parties, ce que recommande d’ailleurs le Coran (sourate II, v. 178-179 ; sourate V, v. 45). Telles étaient les règles de sagesse et de pragmatisme de cette société du passé qui était aussi celle du Coran. On tenait plus que tout à y préserver la vie.
Le Coran, les femmes et l’Arabie du VIIe siècle
Comment donc en est-on arrivé là aujourd’hui, dans le monde musulman, mais aussi en dehors de lui ? Comment, quand il est question d’islam, au fantasme des uns pouvant jusqu’à conduire au crime répond l’invective ou le jugement de valeur pontifiant des autres ? On est ici face à un problème de représentation du passé. Dans le monde musulman, du fait de contingences historiques diverses, la représentation manipulée du passé amenant à en sacraliser les figures est devenue un enjeu du présent. Mais alors qu’en dehors du monde musulman, nous ne souffrons pas du même handicap idéologique, et que ce qu’on appelle l’histoire critique des textes pourrait s’écrire, nous sommes fort loin du compte. Pour le réaliser, il suffit d’observer notre propre usage des mots qui est bien loin de ce qu’il devrait être pour se donner une vision rationnelle et objective de ce qu’on nomme islam.
Pakistanais, Tchétchène, Tunisien… Les nouveaux profils du terrorisme, par Olivier Roy
Caricature négative et positive, deux images fausses du passé
Mahomet, en arabe Muhammad, est ordinairement désigné comme « le Prophète de l’islam ». Cette désignation qui va de soi dans le discours courant, se retrouve le plus souvent de la même façon dans les écrits savants, y compris ceux qui s’inscrivent dans le registre historique. Faisant cela, on ne se rend pas compte qu’on ne fait que produire une formulation de type idéologique. Désigner d’emblée un homme du passé comme « prophète », c’est déjà le confondre avec une figure qui n’est plus tout à fait humaine en tant qu’elle est reliée à la surnature et au divin. On pourrait dire à ce compte que l’image qui attribue à un homme un surplus de sainteté ou de sacralité constitue par rapport à son statut humain une caricature positive.
Le terme caricature renvoie en effet étymologiquement à ce qui « charge » et « leste de poids ». Il s’emploie ordinairement pour désigner une charge négative. La caricature en dessin consiste en effet à exagérer les traits d’un personnage en produisant une déformation qui veut prêter à rire, voire à ridiculiser. Mais, en fait, du négatif au positif, le processus est le même, celui d’un ajout et d’une transformation du réel dans la représentation qu’on en donne. On pourrait donc faire le parallèle entre l’image caricaturale négative et celle qui, à l’inverse, cherche à représenter un surcroît de vertu et de beauté. Au lieu de prêter à rire voire à dénigrer, l’image surchargée de positivité donne à admirer voire à adorer. Elle tend à s’inscrire dans un processus de sacralisation. C’est le cas de la représentation visuelle, celle de l’image sainte comme de l’icône. Mais, d’une façon plus générale, c’est aussi le cas de la figure construite dans le discours, celle qui finit par s’imprimer dans l’imaginaire collectif pour produire une représentation commune. C’est à ce type de représentation que l’on a affaire dans le monde musulman d’aujourd’hui autour de la figure du Prophète. On se mobilise en foule autour de la représentation d’une figure positive partagée que l’on dit offensée par l’image inverse de caricatures de presse qui sont produites dans des pays où cette expression publique de dérision est permise.
Des cieux désirants aux déserts sidéraux, une brève histoire du ciel
On ne peut offenser ni une figure ni une image
Pourtant, si on peut offenser un homme, on ne peut offenser ni une figure ni une image. Aujourd’hui, un homme peut en effet répondre de diverses façons à l’offense qui lui est faite. Il peut le faire en s’en prenant lui-même à celui qui l’offense ou aller devant les tribunaux pour réclamer justice. Par contre, cette action que peut mener un homme vivant, une figure ne le peut pas. Elle est de l’ordre de la représentation mentale oralisée dans un discours, ou pour l’image, de l’ordre de la représentation visuelle. L’homme vivant et la figure ne sont donc pas sur le même plan. En parlant d’offense à la figure du Prophète, aussi adulé soit-il, on est donc clairement dans l’abus de langage. J’avoue être particulièrement étonnée que l’on s’en rende aussi peu compte en tant qu’humains doués de raison et formés depuis maintenant plusieurs siècles à la lecture éclairée des textes.
Régis Debray: « Une fois perdus le bon Dieu et les lendemains qui chantent, que reste-t-il ? »
Jacqueline Chabbi, bio express
Historienne et agrégée d’arabe, Jacqueline Chabbi est professeure honoraire des universités. Elle a renouvelé l’approche des origines de l’islam par l’anthropologie historique. Elle est l’auteure des essais « le Seigneur des tribus » (CNRS, 2013), « le Coran décrypté » (Le Cerf, 2014) et « les Trois Piliers de l’islam » (Seuil, 2016). Dernier ouvrage paru : « On a perdu Adam. La création dans le Coran » (Seuil, 2019). Le 24 septembre dernier, elle a publié un livre de dialogue avec Thomas Römer : « Dieu de la Bible, Dieu du Coran », aux éditions du Seuil.Jacqueline Chabbi (Historienne)
Le droit au blasphème et le droit au respect
Publié le 20-11-20 à 09h48 - Mis à jour le 20-11-20 à 10h26
Si le "droit au blasphème" c’est le droit de manquer de respect aux convictions de l’autre et ainsi de les humilier, cela ne conduit certainement pas à une société fraternelle.
© AFP & D.R.
Une chronique de Charles Delhez sj.
Si, par "droit au blasphème", on entend liberté religieuse, refus de la pensée unique en matière religieuse, droit à un examen libre et donc aussi critique, pour soi personnellement ou dans le dialogue, on ne peut qu’être d’accord. Si, par contre, c’est le droit de manquer de respect aux convictions de l’autre et aux personnes elles-mêmes, sans la moindre délicatesse, et ainsi de les humilier, voilà qui ne conduit certainement pas à une société fraternelle. Selon Wikipédia, en effet, le blasphème désigne à l’origine le fait de "parler mal de quelqu’un, injurier, calomnier". Et l’on n’est pas toujours loin des origines.
Le droit au blasphème ouvre à la violence verbale ou caricaturale. Il opère comme une incitation au mépris voire à la haine qui se cache derrière, directement ou indirectement, en mettant les rieurs de son côté. C’est bel et bien de la provocation, et les conséquences le prouvent. (Je ne vise pas ici le professeur Samuel Paty décapité à Conflans-Ste-Honorine.)
Bien sûr, tuer au nom de Dieu est aussi de l’ordre du blasphème et mérite tout autant d’être condamné. Ce Dieu-là n’est d’ailleurs qu’une idole. J’espère donc que la communauté musulmane se réveillera et prendra de plus en plus conscience du caractère inacceptable de ces comportements aux yeux mêmes de leur foi. Heureusement, des voix plus nombreuses qu’il y a peu s’élèvent dans leurs rangs pour condamner ce fanatisme. Je me souviens avec émotion de la visite de trois croyants musulmans, manifestement envoyés par leur communauté pour me saluer à la fin de la messe, le dimanche de Toussaint. Ils voulaient tout simplement manifester leur sympathie aux chrétiens suite aux attentats en France.
Une "difficulté congénitale"
La "laïcité à la française" est un problème franco-français lié à l’histoire religieuse de l’Hexagone. Les événements de ces jours-ci, quant à eux, relèvent plutôt du fameux "choc des civilisations" de Samuel Huntington. Deux cultures totalement différentes sont en présence. Tentons de les harmoniser plutôt que de les exacerber. Seules les valeurs positives font grandir la fraternité, et la première d’entre elles est sans doute le respect.
Et le droit à l’expression ? Je préfère la façon outre-Atlantique. La frontière n’y est pas aussi étanche entre le privé et le public au niveau religieux. Un président peut faire allusion à sa foi dès son premier discours. En Europe, on soutient les caricatures, mais peu d’hommes politiques oseraient émettre des propos aux relents religieux.
Reconnaissons que chez nos voisins - mais aussi chez nous -, il y a une "difficulté congénitale à donner une place au fait religieux, toutes confessions confondues, comme si les religions constituaient en soi une menace contre la paix civile", ai-je pu lire sous la plume de William Marx, professeur au Collège de France. Et du coup, toutes les grossièretés sont permises. Le risque, craint l’évêque d’Albi, serait de donner l’impression que "la quintessence de l’esprit français réside dans la vulgarité et la malveillance".
Des extrémismes au dialogue public
Le frère dominicain Adrien Candiard, dans son récent Du fanatisme. Quand la religion est malade (Cerf 2020), stigmatise l’exclusion de la théologie dans nos sociétés occidentales, c’est-à-dire d’un discours raisonné et critique sur la foi et sur Dieu. Une société qui se refuse à toute réflexion publique sur la question fondamentale de l’existence de Dieu et des religions, qui exclut toute position croyante du débat public, se condamne à l’apparition d’extrémismes.
Une des solutions réside dans une information juste et bien informée, une permission d’aborder sérieusement ces questions sur la place publique, entre croyants, mais aussi avec les non-croyants, sans être traité aussitôt de ringard ou de blasphémateur. Il ne suffit pas d’alarmer, d’informer, encore faut-il se former. La question religieuse traverse les siècles. Elle est une constante anthropologique. Elle mérite plus que du mépris déguisé en liberté d’expression.